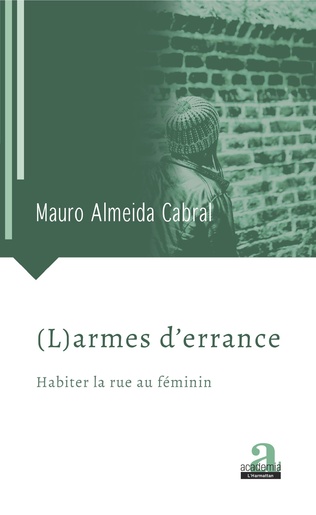Le monde social de la rue est souvent (im)pensé à travers un prisme androcentrique1 qui renforce incontestablement l’invisibilité des habitantes de la rue2. En effet, dans les représentations occidentales, un « SDF » correspond le plus souvent à un homme édenté – et non pas à une femme – qui porte des vêtements répugnants et qui consomme de l’alcool à outrance sur le banc d’un espace public. Inconsciemment, la « question SDF » est donc essentiellement posée afin d’apporter des réponses aux besoins des hommes : des institutions sociales aux pratiques socio-psycho éducatives, la question du genre semble rester un détail trop peu souvent pris en considération au Grand-duché de Luxembourg notamment.
La rue est un espace représentatif de la société où se (re)jouent des relations empreintes de dominations et de violences, tant symboliques que réelles, où les rôles sociaux sont genrés. Ces représentations stéréotypées trouvent leur fondement dans la vie quotidienne où, par exemple, les femmes sont supposées s’occuper des enfants (être une bonne mère) et faire le ménage, entre autres. La place de la femme mérite donc d’être remise en perspective dans ce milieu particulier où la norme masculine semble représenter l’ensemble des phénomènes liés au « sans-abrisme ». Ainsi, les dominations et les violences expérimentées par les habitantes de la rue sont multiples, mais ne sauraient enfermer ces dernières dans un rôle victimaire qui constitue une violence symbolique en soi. Quelles formes de souffrances peuvent-elles éprouver dans leur quotidien ? Que mettent-elles en place pour y résister et en quoi leurs logiques de débrouille remettent fortement en question la notion de « sexe faible » ?
Souffrances dans la ville nue
Les points abordés dans la présente réflexion sont issus de ma clinique d’éducateur de rue et n’ont, en aucun cas, la prétention d’englober et d’aborder tous les aspects et toute la complexité d’une vie à la rue, mais simplement de servir de porte d’entrée pour se pencher sur la question de l’errance féminine et des interrogations qu’elle soulève. Ici, je souhaite me pencher de plus près sur celles qui habitent la rue de manière quasi exclusive et qui, pour diverses raisons, se trouvent distanciées des organisations sociales.
À ce jour, le Luxembourg n’admet aucune organisation sociale spécialisée dans l’accueil des habitantes de la rue. Leurs besoins les plus fondamentaux ne trouvent que trop rarement des réponses adéquates, leurs biographies traumatisantes ont peu d’espaces pour se déployer et être entendues ; leur féminité semble alors s’arrêter aux portes de l’errance. Ce manquement structurel3 – bien que je ne défende pas l’institutionnalisation de ces femmes, surtout s’il s’agit de les (dé)placer dans des espaces qu’elles n’auront pas choisis et qu’elles ne peuvent s’approprier et habiter – a pour conséquence trois réalités parmi tant d’autres que je souhaite aborder ici.
La première est que, par manque d’options solides, elles se tournent souvent vers les foyers dits « pour femmes victimes de violences conjugales » en espérant y trouver un refuge pour échapper aux atrocités d’une vie sur le bitume, mais les conditions d’accueil de ces organisations pensées « pour » les femmes disqualifient ces dernières en grande majorité : en effet, à moins d’être enceinte et à la rue, de préférence accompagnée d’enfants lors de la demande d’aide, d’avoir été victime de violences conjugales4, de ne présenter aucun comportement addictif et trouble psychiatrique ou de demander explicitement de l’aide pour sortir du milieu prostitutionnel, ces femmes ne bénéficieront d’aucun accompagnement psycho-médico-social et psycho-éducatif qui inclurait une solution pérenne au niveau du marché immobilier luxembourgeois. Autrement dit : ces conditions d’accès témoignent inévitablement de la méconnaissance du monde institutionnel, et du monde politique par extension, de ces modes de (sur)vie à la rue.
La deuxième réalité s’inscrit dans « l’obligation » de ces femmes, par l’absence d’alternatives viables, de fréquenter des organisations sociales mixtes qui ne tiennent quasi jamais compte de la question du genre. Souvent, et sans leur prêter une quelconque intention malveillante pour autant, ces organisations renforcent le dénuement psychique et symbolique de la personne lorsqu’il s’agit de poser une demande d’aide : au-delà de devoir « se raconter » encore et encore pour justifier leur présence au sein des organisations, ces femmes m’expliquent qu’elles doivent très souvent partager leur parcours biographique, leur histoire familiale ou encore leur situation administrative et financière. Pour ne pas « perdre la face » dans l’acception de Goffman5, et dans une perspective de survie psychique qui renforce toutefois leur délabrement corporel, elles choisissent de joindre les deux bouts en s’éloignant activement des offres institutionnalisées.
Ceci m’amène donc à aborder la troisième réalité qui est celle des femmes qui, par choix, par ignorance de leurs droits sociaux ou par méfiance envers les organisations sociales - souvent, ces trois options s’assemblent et se complètent - se déplacent dans les interstices urbains en habitant des espaces qui ne sont pas prévus à cet effet : squats, campements, garages, sous-sols de parkings, parcs publics etc. Pour l’anthropologue Michel Agier6, la ville nue est « cet espace de mise en crise de l’humanité » où les conditions de vie souvent inhumaines - tant sur le plan social, physique que symbolique - viennent questionner les marges urbaines et la notion de « faire ville ». Ces femmes investissent parfois des zones sombres de la ville, des « ban-lieux » qui sont des lieux de mise à l’écart dans l’acception de l’auteur susmentionné7 où toxicomanie, prostitution, deal et violences s’enlacent. La ville nue devient ainsi un espace où non seulement le dénuement physique est de mise (absence d’espaces d’intimité, par exemple) mais aussi et surtout où le dénuement psychique et symbolique opère, tel que mentionné précédemment.
Il existe donc un gouffre entre le monde institutionnel et celui de la rue, a fortiori au niveau de la prise en considération du genre : que l’on soit une femme ou un homme, habiter la rue se fait sur des modes intrinsèquement différents, ne serait-ce qu’au niveau de l’accès très difficile aux produits d’hygiène qui pousse ces femmes à faire preuve d’une créativité impressionnante, à l’image de l’utilisation de feuilles de journaux en période de menstruations. Dès lors, il me semble élémentaire de renforcer des pratiques socio-psycho-éducatives qui valorisent le « prendre soin de » et qui favorisent la notion d’altérité où l’Autre est conçu comme étant une personne semblable et unique de par son humanité. Une telle relation éducative, basée sur la confiance réciproque et la « reconnaissance mutuelle » décrite par le psychiatre Jean-Claude Métraux8, permet à l’Autre de se déployer en tant que sujet de sa propre histoire de vie, et certainement pas en tant qu’objet qu’il faudrait « prendre en charge » selon l’éducateur spécialisé et docteur en sociologie politique Dominique Depenne9 qui dénonce une telle expression :
« Sans conteste, c’est accepter de réduire l’Autre à être un objet de “prise” et une “charge” à prendre. (…) Par son appellation même, la prise en charge avoue son désir d’annulation d’Autrui en tant qu’Autre. (…) Il n’est plus qu’un objet de prise en charge, à la merci, au double sens du terme, de ceux qui le prennent en charge : à la merci de leur domination et à la merci de la dette de réciprocité qui s’instaure entre eux. Celui ou celle qui reçoit, doit. »
Aussi paradoxal que cela puisse donc paraître, et même si l’acte de donner peut, a priori, paraître comme étant un acte altruiste, il prolonge inconsciemment la domination sociale et les violences symboliques que vivent les personnes à la rue lorsque celles-ci sont dans l’impossibilité, de quelle nature qu’elle soit, de procéder au contre-don anthropologique théorisé par Marcel Mauss qui permettrait de rééquilibrer ces échanges et ces relations humaines à la rue.
Ces modes de vie où les filets de sécurité sont majoritairement absents (sécurité sociale, accès aux droits sociaux) et qui font référence aux concepts de « désaffiliation » du sociologue Robert Castel10 et de « disqualification sociale » du sociologue Serge Paugam11 placent ces femmes dans des stratégies de survie qui, souvent, mettent en exergue des logiques de domination auxquelles elles font face et qui exposent les différentes formes de violences qu’elles vivent au quotidien.
La quête d’équilibre : entre débrouilles et prises de risques
Je me souviens de ce magasin qui, une fois ses portes fermées, pratique une violence symbolique considérable en maintenant, au-dessus de son entrée principale, la diffusion de musique à un volume démesuré, empêchant ainsi les habitant(e)s de la rue de pouvoir s’y (re)poser, un peu comme les appareils ultrasoniques utilisés pour empêcher les fouines et autres rongeurs de s’installer sous le capot des voitures. Le manque de sommeil, de repos de qualité fait partie de ce quotidien parfois inénarrable et engendre des troubles divers, notamment au niveau de l’humeur et de l’irritabilité, au point d’affecter les cycles menstruels qui peuvent dysfonctionner progressivement, remettant en perspective la notion de corps féminin.
Peu présentes dans les organisations sociales, elles côtoient ainsi les marges de la ville en l’habitant selon des logiques qui sont les leurs afin de pouvoir se mettre un minimum en sécurité. La pratique de la mendicité, de la prostitution de survie ou encore la consommation de drogues font partie de ce quotidien empli d’incertitudes, de désespoir et du sentiment d’urgence permanent. Trouver un espace pour dormir, se nourrir, se mettre en sécurité, faire de l’argent pour assurer la survie et, selon les personnes, satisfaire à leurs comportements addictifs sont des préoccupations parmi tant d’autres auxquelles elles essayent de trouver des réponses. Les agressions physiques, le sentiment d’isolement et d’insécurité ainsi que les prises de risques en lien avec une consommation de drogues non régulée caractérisent ces modes de vie. Les dangers de la rue invitent donc ces femmes à mettre en place des ruses, des bricolages et des débrouilles diverses afin de survivre.
La pratique de la mendicité requiert la mobilisation de logiques d’organisation : non seulement il faut trouver le « bon » endroit, mais aussi le moment propice pour faire la manche. L’utilisation de la ruse permet des inexactitudes lorsque les passants leur demandent de quelle manière l’argent sera utilisé ; il est difficile de faire comprendre à une personne lambda qu’il est parfois plus urgent d’acheter sa dose de drogue pour « ne pas tomber malade »12 que de se procurer quelque chose à manger. Choisir d’aborder directement les passants ou préférer de rester assis sur son carton et « attendre » relève de choix personnels et de la capacité à se surpasser en se mettant à nu devant des inconnus. Les habitantes de la rue choisissent stratégiquement des moments de visibilité afin d’augmenter leurs chances de gagner de l’argent, lors de la manche notamment, et préfèrent l’invisibilité pour ne pas attirer les regards de personnes mal intentionnées de manière générale. Dans ce sens, certaines vont jusqu’à passer par ce que j’ai appelé un « processus de masculinisation » en cachant leurs attributs féminins au maximum : couper les cheveux, adopter un timbre de voix plus grave, s’habiller exclusivement avec des vêtements d’hommes, etc.
Contrairement à la mendicité, la pratique de la prostitution peut se faire dans des espaces différents, plus discrets, à l’abri des regards et de la stigmatisation : ces femmes investissent alors les espaces afin d’éviter la dangerosité de la rue, quitte à parfois courir d’autres risques. En effet, certaines me partagent des épisodes de viols particulièrement brutaux qu’elles ont vécus en investissant ces espaces de l’entre-deux. Pour celles qui sont consommatrices de drogues, vendre son corps en échange de quelques billets leur permet de ne pas tomber « malades » et d’éviter ce sentiment de manque tant appréhendé, quitte à accepter l’inacceptable en concédant des passes violentes à des hommes qui désirent assouvir leurs fantasmes les plus inexprimables et asseoir leur domination sur un corps vulnérable. Les prises de risques sont nombreuses et vont jusqu’au fait d’accepter des relations sexuelles sans préservatif afin d’augmenter un peu le prix d’une passe. Pour anesthésier leurs douleurs corporelles et ne plus ressentir un mal-être existentiel souvent décrit, beaucoup de femmes m’expliquent qu’elles trouvent refuge dans la consommation – parfois régulée, parfois à outrance – d’héroïne par exemple. Ces conduites à risques relèvent parfois d’une vision ordalique qui questionne la mort et peuvent constituer des appels d’aide au social en interrogeant non seulement le droit à la vie, mais aussi leur place dans la société.
Dès lors, l’ethnographie des corps laisse deviner deux fonctions parmi tant d’autres que ceux-ci peuvent jouer dans les interactions quotidiennes : tantôt une fonction de protection (ne pas se laver est une manière de « repousser » son entourage, d’éventuels agresseurs), tantôt une fonction d’intégration sociale (une personne peut habiter la rue et particulièrement soigner son hygiène pour réduire les stigmates). La question de l’équilibre est donc omniprésente et les interstices de la rue requièrent qu’on y prête attention à tout moment : une hygiène « contrôlée » permet de réduire le risque de se faire violer, cependant ce laisser-aller corporel doit être réfléchi pour ne pas dégoûter les passants lorsqu’elles font la manche ou pour maintenir leur capital de séduction/attirance sexuelle lorsqu’elles « choisissent » de se prostituer.
Pour prolonger la réflexion
La question de l’errance féminine ne saurait être homogénéisée dans l’exacte mesure où il n’y a pas de portrait-type de l’habitante de la rue. Les histoires de vie et les biographies peuvent parfois se ressembler, au même titre que leurs trajectoires de survie peuvent paraître similaires, mais les multitudes de réalités subjectives renforcent l’idée de diversité liée à cette question.
Aussi vrai que j’ai souligné l’importance de repenser la place de la femme dans la rue en ne la réduisant pas aux stéréotypes sociétaux et en ne la percevant pas en tant qu’une victime sans le moindre pouvoir d’action, il est élémentaire de faire la même démarche intellectuelle envers les hommes qui ne sauraient être réduits à de simples agresseurs. En effet, contrairement aux représentations collectives, les violences vécues par les femmes à la rue ne sont pas exclusivement le fruit de protagonistes masculins qui en auraient le monopole : j’ai rencontré de nombreuses situations où des femmes ont été violentées par d’autres femmes qui habitaient la rue également.
La question de la santé mentale mériterait certainement une attention plus aigue pour mieux accompagner ces femmes en souffrance au quotidien. De même, au-delà des travailleurs sociaux de rue, qu’ils soient éducateurs spécialisés ou assistants sociaux pour la plupart, il serait élémentaire de pouvoir métisser les pratiques professionnelles en faisant appel aux expertises de psychologues, d’infirmiers, de psychiatres et d’anthropologues, pour ne citer que ces derniers. La prise en compte de la spécificité liée au genre devrait dès lors faire partie des futurs projets pédagogiques, éducatifs et sociaux élaborés par le monde institutionnel et articulés avec le monde politique.