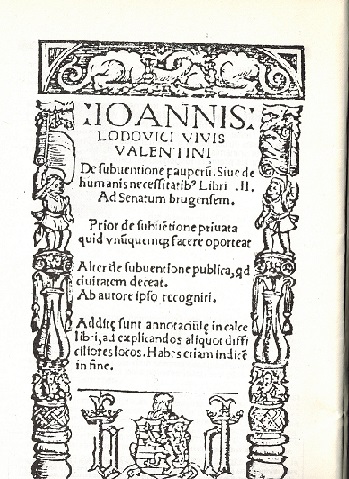(…) L'argent, qui ne fut à l'origine qu'un moyen d'acquérir la nourriture et le vêtement, devint l'instrument universel de l'honneur, de la dignité, de l'orgueil, de la colère, de l'abondance, de la vengeance, de la vie, de la mort, du pouvoir (..) celui qui l'acquiert est déjà tenu pour sage, seigneur, roi, homme de grand et admirable conseil et talent ; mais le pauvre est réputé niais, méprisable, et c'est à peine si on lui reconnaît la dignité d'homme.
(…) On doit donner promptement (..), bien avant que la nécessité étreigne, avant qu'elle ne contraigne à la folie ou à une méchanceté, avant qu'elle n'allume sur le visage du nécessiteux la honte et la rougeur de solliciter, parce que ceci est une peine beaucoup plus lourde que ce que vaut l'argent.
(…) Nos bienfaits ne doivent pas se limiter au don d'argent. On doit faire le bien d'abord, en rapport avec qui est propre à l'âme, comme l'espérance, le conseil, la prudence et les préceptes pour la vie ; ensuite, avec ce qui est inhérent au corps, à savoir, la présence matérielle, les paroles, les forces, le travail et l'assistance ; et enfin avec ce qui est externe, comme la dignité, l'autorité, la constance, les amitiés et l'argent en y comprenant tout ce qui s'acquiert par lui.
(...) Ne nous attribuons aucune gloire, parce que nous donnons quelque peu, car nous ne le donnons pas de nos biens, mais nous rendons à Dieu ce qui est sien.
(...) Mais actuellement, nous laissons les mendiants pourrir dans leur besoin ; car que peuvent-ils tirer de leurs immondes misères sinon les vices. (...) A cause de cela, leurs fautes sont des misères humaines en quelque sorte inévitables, tandis que les nôtres sont volontaires.
(...) Elle ne peut subsister longtemps une république où chacun ne soigne que ses affaires et celles de ses amis et où nul ne se soucie des affaires communes.
(...) La république est juste chaque fois que les citoyens et conseillers de ceux qui gouvernent s'en réfèrent à l'utilité publique.
(...) Parmi les pauvres, il en est qui vivent dans les maisons communément appelés hôpitaux. D'autres mendient publiquement et d'autres supportent leurs infortunes comme ils le peuvent, chacun chez soi.
J'appelle (hôpitaux) hospices, ces établissements où l'on nourrit et soigne les malades, où l'on entretient un certain nombre de nécessiteux, où l'on éduque les garçons et les filles, où l'on élève les enfants, où l'on enferme les fous et où les aveugles passent leur vie.
Que ceux qui gouvernent la cité sachent que tout ceci incombe à leurs soins. Il n'y a aucune raison de s'en décharger ou de s'en excuser en alléguant comme prétexte les volontés des fondateurs.
(...) Il faut donc que chacune de ces maisons soit visitée et recensée par deux sénateurs ou deux députés revêtus de cette autorité par ordre du gouvernement, accompagnés d'un greffier. Qu'ils notent et prennent justification des ressources et du nombre et des noms de ceux qu'on y garde et en même temps du motif pour lequel chacun s'y trouve. De tout cela, il faut rendre compte et faire rapport aux juges et au sénat en son tribunal.
Que ceux qui supportent leur pauvreté à domicile soient également recensés, conjointement à leurs enfants, par deux députés dans chaque paroisse, en notant leurs besoins, la manière dont ils vivaient antérieurement, par quelles circonstances ils ont été réduits à la pauvreté. Par les voisins, on pourra aisément connaître quel genre de gens ils sont, quelles sont leurs mœurs et coutumes. Mais, en ce qui concerne un pauvre, que l'on ne s'informe pas auprès d'un autre pauvre, car l'envie jamais ne fait trêve. De tout cela, on rendra un compte individuel aux juges et au gouvernement. Et s'il advenait que quelques-uns subissent inopinément malheur, qu'ils le fassent savoir au tribunal par quelqu'un de ses membres et que l'on donne, à ce sujet, la suite qui conviendra selon la qualité, l'état et la condition du nécessiteux.
Les mendiants vagabonds sans domicile certain, qui sont sains déclareront leurs noms et prénoms devant les juges et gouverneurs et en même temps, la raison qui les force à mendier. Mais que ceci se fasse ~n quelque lieu ou place déterminée pour que n'entre pas semblable chiourme à la maison ou à la salle du tribunal ou du gouvernement.
Que les malades fassent de même devant deux ou quatre commissaires assistés d'un médecin, pour que tout le conseil n'ait pas à s'occuper de les voir et qu'on les prie de déclarer qui les connaît, qui puisse donner témoignage de leur vie.
A ceux que le gouvernement choisira pour examiner et exécuter ces dispositions, que soit donné le pouvoir d'obliger, de contraindre et même d'emprisonner, pour que les juges puissent connaître celui qui n'obéira pas.
(...) L'on ne doit pas permettre que quiconque vive oisif dans la cité, où, comme dans une maison bien gouvernée, il convient que chacun ait son office.
Il faut prendre en considération l'âge et le défaut de santé ; mais avec la précaution qu'on ne nous trompe pas sur la simulation ou le prétexte d'indisposition ou de maladie, ce qui arrive souventes fois. Pour l'éviter, on recourra au jugement des médecins, punissant celui qui induira en erreur.
S'il se rencontre des mendiants bien portants, que les étrangers soient remis à leurs cités ou bourgades, ce qui d'ailleurs est ordonné par le droit civil, mais en leur donnant un viatique. Car ce serait inhumain que de renvoyer le nécessiteux sans ressources pour le voyage ; et qui agirait de la sorte que ferait-il d'autre que de pousser au vol ? Cependant, s'ils sont de villages ou de petites localités affligés ou ravagés par la guerre, alors, on les considérera comme des concitoyens, tenant compte de ce qu'enseigne Saint Paul, à savoir : Que parmi les baptisés par le Saint Sang du Christ, il n'y a ni Grec, ni barbare, ni Français, ni Flamand, mais une nouvelle créature.
Aux enfants de la patrie, on demandera s'ils connaissent quelque métier. Ceux qui n'en connaissent aucun, s'ils sont d'un âge adéquat, doivent être instruits, dans celui pour lequel ils ont le plus de dispositions, si c'est possible ; sinon, dans celui qui s'en rapproche le plus. (Comme quoi, celui qui ne pourra coudre des vêtements, coudra des guêtres, des bottines ou des chaussures). S'il est d'âge mûr ou d'intelligence trop grossière, que lui soit enseigné un métier plus facile, et finalement, celui que quiconque peut apprendre en peu de jours, comme creuser la terre, tirer de l'eau, porter quelque chose sur les épaules ou dans une petite charrette à une roue, accompagner le magistrat, être son aide pour quelques commissions, (aller où on l'enverra porter lettres ou mandats), ou soigner et conduire les chevaux de louage.
Ceux qui gaspilleront leur fortune de mauvaises et sottes manières, comme au jeu, chez les prostituées, dans le concubinage, par le luxe ou la goinfrerie, (on les nourrira par nécessité, mais qu'à ceux-là on réserve les travaux les plus pénibles).
Pour tous ceux-ci, il ne manquera pas d'ateliers où ils seront admis. Ceux qui travaillent la laine, dans la région d'Armentières où, pour mieux dire, la plupart des fabricants se plaignent de la rareté des ouvriers. Ceux qui tissent les vêtements de soie, à Bruges, admettraient et guideraient des adolescents quelconques, ne fût-ce que pour faire tourner et rouler certains tourniquets ou raclettes ; ils rétribuaient même journellement chacun d'un sou, à peu près, en plus de la nourriture. Et ils ne peuvent trouver personne qui accepte, parce qu'aux dires mêmes de leurs parents, en allant mendier, les enfants rapportent plus de bénéfices à la maison. Pour qu'il ne manque point d'ouvriers aux fabricants et qu'il ne manque pas d'atelier aux pauvres, que l'autorité publique assigne à chaque fabricant un certain nombre de ceux qui ne peuvent avoir un atelier à soi.
Si certains se montrent appliqués selon leurs aptitudes, qu'ils ouvrent un atelier. A ceux-là, on leur confiera, soit les travaux publics de la cité, soit les travaux nécessaires dans les hôpitaux, afin que tous les capitaux et intérêts qui, dès le principe, furent destinés aux pauvres, se consomment parmi les pauvres.
(…) Les enfants exposés auront leur hôpital où on les alimentera, à l'école ils apprendront les premières lettres et bonnes mœurs et ils y seront maintenus.
(…) Veuille Dieu que nous puissions arriver entièrement à ce qu'il n'y ait plus aucun pauvre en cette cité.
(…) Qui agit le plus humainement ? Ceux qui veulent que les pauvres croupissent dans leurs immondices (…) et toutes leurs misères ? Ou ceux qui imaginent les moyens pour les tirer d'un état si malheureux, gagnant ainsi des hommes qui autrement seraient demeurés inutiles et perdus ?
(…) Ce serait un grand honneur pour la cité en laquelle ne se voit nul mendiant ; car cette multitude de mendiants est l'indice, chez les particuliers, de malice et d'inhumanité et, chez les magistrats, de négligence du bien public.